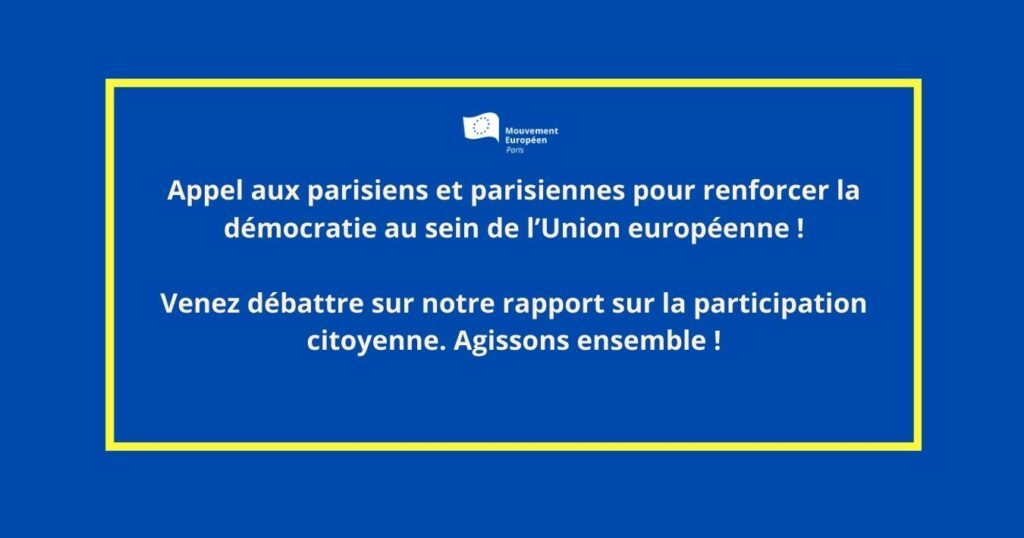
Mouvement Européen Paris
Projet du 6 mai 2025
La démocratie en Europe : Participation citoyenne
Partie 1
Préface
Le document qui suit est le résultat d’un travail de réflexion entrepris dans le but de renforcer la base démocratique de l’intégration européenne.
Il s’agit d’un projet élaboré par un groupe de travail composé de membres du Mouvement Européen Paris. Il est destiné à lancer un large débat pour faire entendre la participation citoyenne et peut être remis aux instances nationales et européennes et diffusé aux organisations de la société civile et aux médias. Les propositions qui suivent peuvent être réalisées par un nouvel élan dans le cadre existant des Traités.
Le document est destiné à une large diffusion. Il est évolutif et peut être complété en fonction des discussions qui vont s’engager.
Résumé et propositions d’action
Le contexte
-
- En France, en Europe et dans le monde, les indicateurs d’alerte sont au rouge : crise économique qui perdure, économie à croissance faible, situation précaire de l’emploi, réchauffement climatique, inégalités et pénuries au niveau du développement mondial (l’énergie, l’eau, denrées alimentaires).
-
- Jamais les problèmes de la planète n’ont été aussi clairement identifiés. Des propositions lucides sont sur la table. Il ne manque pas de discours alarmistes, le mécontentement grogne, le cynisme et le fatalisme augmentent. Mais face aux enjeux sociétaux, le fatalisme n’est pas acceptable.
-
- Un sursaut est nécessaire pour gérer le présent et préparer l’avenir. Quelle que soit notre place dans la société, nous sommes tous redevables des blocages et nous pouvons tous être porteurs d’espoirs. La modernisation des institutions et la moralisation de la vie politique sont des éléments essentiels qui demandent à être appuyés par l’action citoyenne, à travers les partis politiques, les associations et le débat participatif.
-
- Les recommandations qui suivent cherchent à lancer un signal d’alerte, générer une réflexion sur les moyens d’agir, tant sur le plan national qu’européen. Elles s’appuient sur les considérations du rapport qui figure dans la partie 2 de ce document.
Les propositions d’action prioritaire
Visibilité et communication au niveau de l’action politique
-
- Encourager l’action soutenue des instances communautaires et des parlementaires européens par la recherche du dialogue avec les citoyens des pays Membres ;
-
- Faire usage de l’Union interparlementaire pour la démocratie comme moyen d’échange et de communication sur les acquis et les défis de l’Union Européenne ;
-
- Assurer la présence régulière, en cours de mandat, des parlementaires européens dans la vie politique nationale en expliquant les enjeux et les priorités de l’action européenne ;
-
- Au niveau des pays Membres, encourager les bureaux représentatifs de la Commission Européenne à rechercher le débat citoyen ;
-
- Augmenter l’ancrage territorial local des eurodéputés en ce qui concerne l’impact des politiques européennes.
Information et éducation
-
- Élargir le programme « Europa Expérience » présent actuellement dans quelques pays européens en l’appliquant à un niveau décentralisé avec le soutien des instances municipales et régionales ;
-
- Créer une ou plusieurs chaînes européennes de télévision publique dans les pays Membres ;
-
- Au niveau de l’éducation, intégrer la connaissance des affaires européennes dans les curricula d’enseignements obligatoires des collèges et lycées ;
-
- Rendre obligatoire une ou plusieurs visites des élèves de l’enseignement secondaire aux instances communautaires.
Le rôle du Mouvement Européen
14. Renforcer le partenariat avec d’autres organisations actives sur les questions européennes ;
15. Organiser au moins une fois par an un débat sur la démocratie en Europe, avec la présence de députés européens ;
16. Organiser des rencontres régulières avec des experts, des députés européens et des institutions communautaires pour sensibiliser aux enjeux européens, avec des sujets concrets comme l’impact des politiques européennes et l’engagement civique ;
17. Proposer des activités ludiques comme des simulations de débats parlementaires pour expliquer le fonctionnement des institutions européennes ;
18. Organiser des rencontres entre citoyens et élus pour échanger sur leurs attentes concernant des projets européens ;
19. Collaborer avec des plateformes comme ensemble.eu pour toucher un public plus diversifié ;
20. Travailler avec Europa Expérience pour mutualiser ses actions et proposer des événements conjoints ;
21. Développer des vidéos, des podcasts et des articles pour prolonger l’impact des initiatives et toucher un public large via les réseaux sociaux ;
22. Discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la vie démocratique ;
23. Mettre en place des indicateurs des actions et adapter les initiatives en fonction des contributions des participants.
Le rôle de l’Association Participer
24. Dans le cadre de ses activités, l’Association Participer contribuera à la réflexion et au débat citoyen sur les changements fondamentaux et continus de nos sociétés au niveau national et européen, face aux menaces de conflits et aux défis du développement durable.
Partie 2 Le rapport « La démocratie en Europe »
25. Pour instaurer la crédibilité de l’action de l’Etat, il est essentiel d’assurer le bon fonctionnement des institutions de la démocratie représentative aux niveaux national, régional et communal. La responsabilité d’une bonne gestion doit s’étendre à tous les corps intermédiaires, y compris les associations industrielles, patronales et syndicales et les organisations professionnelles. Une dose de participation des employés aux conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises contribuera à une bonne gestion à long terme.
26. En supplément, il s’agit de développer les éléments de la démocratie directe et participative en encourageant le débat citoyen à la base, qui pourra se prolonger par des initiatives de votation populaire et des pétitions portant sur les propositions législatives et l’action administrative.
-
- Le cadre institutionnel
-
- Les traités constitutifs de l’Union Européenne complétés par la Charte des Droits Fondamentaux des citoyens de l’Union intégrant les principes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’action des institutions européennes (la Commission, le Conseil, le Parlement, la Cour de Justice) offrent un cadre large et évolutif pour la démocratie représentative. En outre, les articles 11 et 24 du Traité de l’Union Européenne prévoient des possibilités d’initiative citoyenne et définissent les conditions de recevabilité de ces initiatives.
-
- Les différentes étapes prévues pour le lancement des initiatives citoyennes sont les suivantes :
-
- Soumission par le groupe d’organisateurs d’un formulaire d’enregistrement auprès de la Commission européenne ;
-
- Collecte des déclarations de soutien ;
-
- Publication et audition publique ;
-
- Examen par la Commission et avis du Parlement européen.
29. À ce jour, un nombre très limité d’initiatives a été présenté à la Commission, qui a effectué des analyses juridiques et politiques, mais aucune n’a abouti à un stade plus avancé.
30. La suite d’une initiative de la présidence française, le Parlement européen, conjointement avec le Conseil et la Commission, a organisé la conférence sur l’avenir de l’Europe avec pour objectif d’offrir aux citoyens européens un nouvel espace pour débattre des priorités d’action et des défis auxquels l’Europe se trouve confrontée. Il y a eu 18 conférences régionales, toutes intergénérationnelles, mais avec peu de représentation des agriculteurs, des artisans, commerçants et ouvriers. La mise en place d’un pouvoir citoyen à plusieurs échelons (participation au débat, à la décision et au suivi) a fait part des priorités d’action retenues.
31. Figuraient parmi les recommandations de la Conférence les propositions suivantes :
-
- Informer les citoyens des décisions importantes portant sur les questions européennes ;
-
- Encourager le débat sur les décisions publiques portant sur les questions européennes
-
- Assurer la transparence des contacts entre représentants de la Commission et des parlementaires européens avec les lobbyistes ;
-
- Établir une nouvelle chaîne de télévision relative à l’action des institutions européennes.
32. Le 17 juin 2022, la Commission a publié une prise de position sur ce rapport sous le titre « Conférence sur l’avenir de l’Europe : transformer une vision en action concrète ». Le rapport sur l’avenir de l’Europe a fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale française le 14 juin 2023. Depuis lors, aucune action de suivi n’a pu être constatée.
33. Les instances européennes ont récemment lancé une action d’information importante de sensibilisation des citoyens à travers les Centres Europa Expérience qui ont été mis en place dans quelques États Membres de l’Union comme l’Allemagne, la France et l’Italie. Il serait intéressant d’évaluer l’action de ces centres du point de vue de leur rayonnement.
b) Les initiatives de débat citoyen en Allemagne et en France
-
- Il existe en Allemagne une multitude d’initiatives citoyennes plus ou moins structurées et principalement au niveau communal, soit informelles, soit fondées sur un encadrement réglementaire. Dans ce cadre, le citoyen apparaît comme un partenaire de la vie politique à l’échelon décentralisé, car son expérience et son engagement sont recherchés.
35. Une publication de la Fondation Bertelsmann donne un aperçu des initiatives existantes, de la sélection des projets et des procédures de suivi au niveau des conseils municipaux.
36. A Francfort-sur-Main, une nouvelle initiative, le “Bürgerverein Demokratieort Paulskirche“, s’est dotée d’un champ d’action plus large que le niveau municipal. Elle cherche à renforcer le débat citoyen sur tous les sujets politiques et culturels en Allemagne et en Europe.
37. La France a connu plusieurs exemples d’action citoyenne, tous organisés au niveau national par le pouvoir exécutif. Les principales réalisations ont été les suivantes :
-
- La convention citoyenne sur le climat (rapport du 29 janvier 2023)
-
- La convention citoyenne sur la fin de la vie (rapport du 2 avril 2023)
-
- Le Conseil national de la refondation, lancé le 8 septembre 2022, structuré en conseil plénier, ateliers thématiques et concertations au niveau territorial.
38. La Constitution française prévoit la possibilité de référendums d’initiative populaire soumis à des conditions étroitement définies. Jusqu’ici, aucun projet de ce genre n’a vu le jour.
c) Les défis
39. Les dispositifs sur les plans européen et national, si utiles qu’ils puissent être, ne sauraient pas satisfaire les besoins d’un débat citoyen plus large et non contrôlé par un exécutif qui détermine la composition des instances de consultation et les modalités de suivi des recommandations.
40. L’intervention des institutions européennes est en train de s’élargir aux situations qui dépassent l’intégration économique et qui touchent directement l’intérêt des citoyens. À titre d’exemple, l’Union européenne est aujourd’hui tenue d’agir à différents échelons face à une variété de problèmes concernant l’environnement, le social, la justice, la politique étrangère et de la défense, thèmes pour lesquels l’interaction avec les politiques nationales est en pleine évolution.
41. En même temps, force est de constater la montée des euroscepticismes dans différents pays membres de l’Union. L’action des instances communautaires n’est ni suffisamment expliquée ni comprise face aux communications émanant de partis souverainistes dans leur quête de pouvoir. En l’absence d’une information fiable et soutenue, les possibilités d’un débat citoyen restent souvent illusoires.
42. La démocratie est en crise à plusieurs niveaux :
-
- La mondialisation non maîtrisée;
-
- Les dysfonctionnements de la vie politique ;
-
- Les tensions sociales;
-
- La menace de conflits internationaux ;
-
- Un système financier à haut risque ;
-
- La dégradation de l’environnement.
43. Face à ces défis, toute action efficace dépendra de la prise de conscience des risques systémiques et des possibilités de les enrayer et de les surmonter :
a)-Le Parlement Européen est élu au suffrage universel tous les cinq ans, mais jusqu’ici la participation électorale est restée faible et les campagnes électorales sont souvent confinées à des intérêts purement nationaux. En outre, les candidats, une fois élus, sont largement absents dans le débat national où ils pourraient faire valoir les perspectives européennes.
b)- Comment répondre aux défis démocratiques persistants : créer de nouveaux mécanismes de consultation au niveau des institutions européennes en complétant le dispositif des traités ou bien travailler dans le cadre des traités existants en y apportant des initiatives allant dans le sens du débat démocratique ? Pour être efficace, il faudra privilégier la seconde proposition. En effet, le cadre institutionnel européen et national offre suffisamment de possibilités d’action immédiate pour développer la participation citoyenne. Allant au-delà, il faut préconiser un mouvement large, spontané et décentralisé, mobilisant le débat citoyen à la base.
c)-Dans l’organisation de ce débat, il faudra tenir compte des avantages et des risques de l’usage de l’intelligence artificielle qui ne saurait se substituer à l’interaction entre citoyens. À partir de données collectées et d’analyses sophistiquées développées par des algorithmes, il est désormais possible de cibler dans une population les individus sensibles à des idéologies, de les encourager à se regrouper et de faire basculer les majorités. La possibilité d’automatiser les campagnes de propagande est offerte à moindre coût à des acteurs privés ou publics de manipuler l’opinion publique à partir de vérités interprétées, de rumeurs ou de « fake news ». Les régimes autoritaires s’appuient sur un usage intensif de ce type de manipulation pour contrôler leurs propres populations ou encourager la division et le désordre en affaiblissant le processus démocratique. L’Union européenne est consciente de ces risques et met en place des mesures pour renforcer la responsabilité des plateformes et défendre la liberté des citoyens. Il s’agit là d’un aspect important à suivre pour la protection de la participation démocratique.
d) Les perspectives et moyens d’action
44. Outre les démarches existantes, il est important d’élargir le débat citoyen aux éléments prioritaires de la politique européenne. En s’inspirant des propositions avancées par la conférence sur l’avenir de l’Europe, les actions suivantes devraient être envisagées :
-
- Améliorer l’information des citoyens sur le fonctionnement des institutions européennes et leurs enjeux politiques ;
-
- Mobiliser les médias en les encourageant à couvrir les affaires européennes plus régulièrement et plus exhaustivement, tout en luttant contre la désinformation et les ingérences malveillantes ;
-
- Sensibiliser les partis politiques et les organisations de la société civile aux questions européennes ;
-
- Engager les eurodéputés à participer régulièrement au dialogue citoyen sur les enjeux européens ;
-
- Intégrer systématiquement la connaissance de l’Europe et le fonctionnement de ses institutions dans les curricula des collèges et lycées ;
-
- Évaluer régulièrement les progrès à tous les niveaux pour l’amélioration de l’information et le débat citoyen.
45. Outre la participation prévue par les traités et la législation, ces débats citoyens devraient se poursuivre à tous les niveaux par une multitude d’efforts sous l’impulsion de la société civile. Le Mouvement européen, en se dotant de ressources nécessaires et en conjonction avec d’autres associations comme Participer, peut jouer un rôle catalyseur dans l’organisation et le suivi des débats.
Ceci est une base de travail. Nous vous invitons à venir débattre avec nous de ce rapport dès juin 2025, à apporter vos connaissances, vos remarques, et à agir ensuite avec nous pour faire progresser la démocratie à Paris et en Europe.
Rapporteur : Rainer Geiger
Contributeurs : Jean-Claude Houdoin, Maria Sow, Yves Collin et Nirina Moutou.
